I. Généralités
1. Définition
Un capteur optique transforme l’énergie lumineuse en énergie électrique, tous les capteurs que nous allons voir sont par conséquent des capteurs de flux lumineux. L’action d’un capteur optique est représentée par le schéma de la figure 1. Figure 1
Figure 1
2. Les deux types de capteurs
Imaginons que nous soyons des inventeurs chevronnés du début du XXème siècle. Et que nous ayons pour mission de construire des capteurs optiques. Or si vous voulez capter quelque chose, la première question que vous devez vous poser porte sur la nature de ce que vous voulez capter ; première question : qu’est ce que la lumière ? A cette question nous répondons : la lumière est une onde électromagnétique. Bien, nous savons maintenant que la lumière est une onde, comment déceler cette onde ? Pour répondre à cette question, nous devons trouver comment agit une onde électromagnétique sur la matière… réalisons donc une petite expérience. On place une petite plaque noire au soleil durant quelques instants. Lorsqu’on revient : la température de la plaque a considérablement augmentée. On en déduit qu’une onde électromagnétique a la faculté de provoquer une variation de température d’un corps qui la reçoit. Nous venons de trouver une première méthode de détection de la lumière qui est à l’origine d’un premier type de capteur : les capteurs thermiques. Propulsons nous maintenant quelques dizaines d‘années plus tard, après l’intervention de Einstein, Schrödinger, Pauli et Dirac. La mécanique quantique est alors bien établie, et la physique se base maintenant sur la quantification. La lumière n’est plus vue comme une onde mais comme un ensemble de particules sans masse se déplaçant à la vitesse c et d’énergie : les photons. Ce que nous devons capter ce n’est donc plus une onde mais une particule.
La démarche est la même, il nous faut savoir comment agit un photon lorsqu’il arrive sur la matière, c’est de cette manière que nous pourrons mettre en œuvre un capteur. Les expériences pour mettre en évidence cette action sont un peu plus délicates à réaliser, mais d’une manière générale, on peut dire qu’un photon a la faculté de faire passer un électron de la matière dans un état excité, c’est l’effet photoélectrique. Et nous voilà avec une idée de génie : si on arrive à récupérer cet électron, et à le faire circuler dans un circuit, nous obtiendrons un courant. C’est le principe des détecteurs photoniques.
: les photons. Ce que nous devons capter ce n’est donc plus une onde mais une particule.
La démarche est la même, il nous faut savoir comment agit un photon lorsqu’il arrive sur la matière, c’est de cette manière que nous pourrons mettre en œuvre un capteur. Les expériences pour mettre en évidence cette action sont un peu plus délicates à réaliser, mais d’une manière générale, on peut dire qu’un photon a la faculté de faire passer un électron de la matière dans un état excité, c’est l’effet photoélectrique. Et nous voilà avec une idée de génie : si on arrive à récupérer cet électron, et à le faire circuler dans un circuit, nous obtiendrons un courant. C’est le principe des détecteurs photoniques.
3. Caractéristiques d’un capteur
Quel qu’il soit : photonique ou thermique, un capteur optique est caractérisé par les mêmes grandeurs. - La sensibilité C’est une caractéristique fondamentale des capteurs que nous appliquons aux capteurs optiques. Soit un capteur recevant un flux lumineux, F, la réponse de ce capteur est R (courant ou tension), on définit alors la sensibilité par :
 . Un capteur linéaire est commode d’utilisation, mais la linéarité n’est pas nécessaire pour utiliser un capteur, un capteur est exploitable une fois qu’on connaît sa réponse qu’elle soit linéaire ou pas.
- La réponse spectrale
Tout comme un système électrique possède une bande passante, la réponse d’un capteur optique est fonction de la longueur d’onde de la lumière incidente. Un capteur ne répond pas de la même manière dans l’infrarouge et dans l’ultraviolet. On notera donc plus généralement la réponse d’un capteur
. Un capteur linéaire est commode d’utilisation, mais la linéarité n’est pas nécessaire pour utiliser un capteur, un capteur est exploitable une fois qu’on connaît sa réponse qu’elle soit linéaire ou pas.
- La réponse spectrale
Tout comme un système électrique possède une bande passante, la réponse d’un capteur optique est fonction de la longueur d’onde de la lumière incidente. Un capteur ne répond pas de la même manière dans l’infrarouge et dans l’ultraviolet. On notera donc plus généralement la réponse d’un capteur  .
Remarque : Il découle de cette propriété que la sensibilité est aussi fonction de la longueur d’onde.
- Le rendement quantique
C’est une caractéristique propre aux détecteurs photoniques. Nous avons vu que dans ces capteurs, un photon incident provoquait l’excitation d’un électron. En réalité un photon incident ne provoque pas l’excitation d’un électron mais de
.
Remarque : Il découle de cette propriété que la sensibilité est aussi fonction de la longueur d’onde.
- Le rendement quantique
C’est une caractéristique propre aux détecteurs photoniques. Nous avons vu que dans ces capteurs, un photon incident provoquait l’excitation d’un électron. En réalité un photon incident ne provoque pas l’excitation d’un électron mais de  électrons.
électrons.  est le rendement quantique, il s’agit du nombre d’électron excités pour un photon incident.
est le rendement quantique, il s’agit du nombre d’électron excités pour un photon incident.
II. Les capteurs photoniques
1. Deux types de capteurs photoniques
Nous commencerons par les capteurs photoniques car ce sont de loin les plus courants de nos jours. Lorsqu’un photon arrive sur ces capteurs, il provoque l’excitation d’électrons, on différenciera deux types de capteurs photoniques suivant le devenir de cet électron : - Soit l’électron reste dans le matériau, et le capteur est dit à effet photoélectrique interne. C’est le cas de tous les capteurs à semi-conducteur. - Soit l’électron est éjecté hors du matériau et le capteur est dit à effet photoélectrique externe. C’est le cas du photomultiplicateur. Dans cette partie, nous donnerons une large place aux détecteurs à semi-conducteurs, car, une fois encore, ce sont les plus courants. Nous détaillerons ensuite le principe de fonctionnement du photomultiplicateur car il est utilisé dans certains spectromètres et possède une sensibilité remarquable.2. Principe des capteurs à semi-conducteurs
Les semi-conducteurs sont des matériaux tout à fait remarquables, ils sont parfois isolants et parfois conducteurs. Revenons quelques instants sur la structure de ces matériaux. - Semi-conducteur homogène Nous savons, depuis l’élaboration de la théorie quantique que les niveaux énergétiques sont quantifiés. Dans un matériau semi-conducteur, il existe deux bandes d’énergie : - une bande de valence pleine d’électrons - une bande de conduction totalement vide à T=0K et à l’équilibre. Ces bandes d’énergies sont séparées par un intervalle où aucun niveau d’énergie n’existe : c’est le GAP du semi-conducteur. Lorsque la bande de valence est pleine, le matériau est isolant car les électrons ne peuvent pas se déplacer librement. Pour qu’un électron assure la conduction du courant, il doit passer de la bande de valence à la bande de conduction. En effet lorsqu’un électron se retrouve dans la bande de conduction, il peut prendre tous les niveaux d’énergie de cette bande et peut donc se déplacer dans le matériau : c’est cette liberté des électrons de la bande de conduction qui est responsable de la conduction dans les semi-conducteurs. Mais quel est le prix de cette liberté ? Pour passer de la bande de valence à la bande de conduction, l’électron doit traverser le GAP, il doit donc posséder l’énergie nécessaire pour réaliser ce saut. L’énergie peut être fournie de diverses manières : - énergie thermique - énergie lumineuse, c’est un photon qui permet le passage (c’est ce qui nous intéresse ici) On peut donc imaginer le capteur suivant : Un matériau semi-conducteur est exposé à un rayonnement, lorsqu’un photon entre en contact avec le matériau, un électron passe de la bande de valence à la bande de conduction ce qui provoque l’apparition d’un courant dans le matériau. Remarque : lors du passage d’un électron de la bande de valence à la bande de conduction celui-ci laisse derrière lui (dans la bande de valence) un trou qui va aussi participer à la conduction. Nous verrons que ce capteur est effectivement opérationnel mais il possède un temps de réponse plutôt médiocre, de ce fait les capteurs les plus performants ne sont pas fait d’un seul semi-conducteur homogène mais de deux semi-conducteurs. -Dopage type N et dopage type P Il est très courant d’ajouter à un semi-conducteur tel que le Silicium un atome d’arsenic (As), on dit alors qu’il est dopé N. Voyons qualitativement l’effet de ce dopage. Le silicium possède quatre électrons de valence alors que l’arsenic en possède cinq. Il existe donc dans le matériau des électrons très peu liés et par conséquent fort enclin à passer dans la bande de conduction. A température ambiante, tous ces électrons sont passés dans la bande de conduction et le matériau possède un excès de porteurs de charge négatifs d’où le nom « dopé N ». Par ailleurs, il est tout aussi courant d’ajouter au silicium des atomes de bore. Le bore étant trivalent, le matériau se retrouve avec des trous (charges positives) dans la bande de valence, on dit qu’il est dopé P. -Jonction PN Voyons maintenant ce qu’on obtient si on rassemble un semi-conducteur dopé N et un semi-conducteur dopé P. Les charges négatives du dopé N vont être attirés par le dopé P, inversement les charges positives du dopé P vont être attirés par le dopé N. Il y a donc un mouvement de charge qui s’arrête lorsque les charges se sont toutes déplacées, il existe alors au niveau de la jonction un champ électrique dirigé du semi-conducteur dopé N vers le semi-conducteur dopé P (cf. Figure 1).
Figure 2
3. La photodiode
Une photodiode est une jonction PN à base de silicium. Lorsqu’un photon arrive sur la jonction PN, il est absorbé et provoque la création d’une paire électron-trou. Le champ électrique qui règne au niveau de la jonction sépare les porteurs de charge : l’électron se déplace vers la zone P et le trou vers la zone N. -Photodiode en circuit ouvert En circuit ouvert, les électrons et les trous créés par les photons s’accumulent de part et d’autre de la jonction, il apparaît donc une différence de potentiel au borne de la photodiode : c’est l’effet photovoltaïque. Remarque : cet effet est délicat à utiliser pour réaliser un capteur en revanche il permet de reconnaître le coté P de la photodiode, c’est celui qui possède le potentiel le plus élevé. -Photodiode polarisée en inverse On dit qu’une diode est polarisée en inverse lorsqu’on relie la borne + d’un générateur au coté N de la diode et la borne – au coté P. Lorsqu’on réalise le montage deux précautions sont à prendre : - mettre une résistance de protection en série au cas où on polariserait en direct) - ne pas dépasser la tension inverse maximale (quelques volts). Le montage d’une photodiode en polarisation inverse est donné par la figure 3.
Figure 3

Figure 4



Figure 5
4. Le phototransistor
Un transistor est constitué de deux jonction PN. Il possède généralement trois pattes :- la base
- le collecteur
- l’émetteur
Le schéma d’un transistor NPN est donné figure 6.

Figure 6


Figure 7

5. La photorésistance
La photorésistance est constitué d’un matériau semi-conducteur homogène, son principe de fonctionnement, nous l’avons trouvé au paragraphe II.2 . Les photons incidents provoque le passage d’un électron de la bande de valence à la bande de conduction, plus il y a d’électrons dans la bande de conduction, plus le matériau devient conducteur et par conséquent lus sa résistance diminue. La résistance varie de manière importante, de quelques MO dans l’obscurité à quelques kO sous éclairement. Un des montages les plus courants utilisant une photorésistance consiste à imposer une tension fixe aux bornes de la résistance et à mesurer le courant I qui traverse le capteur (cf. figure 8).
Figure 8
6. Le photomultiplicateur
Un photomultiplicateur est constitué d’une photocathode (mince plaque métallique recouverte d’alcalin) suivie par un dispositif multiplicateur d’électrons, puis par une anode qui collecte les électrons (cf. figure 9).
Figure 9
III. Les capteurs thermiques
Nous avons vu un large éventail de capteurs photoniques, en ce qui concerne les capteurs thermiques, nous nous contenterons de deux exemples :- La thermopile
- Le capteur pyroélectrique
1. La thermopile
Le principe des capteurs thermique ayant été exposé au paragraphe I. nous ne nous nous contenterons de le résumer en ces quelques mots : Un rayonnement thermique provoque l’échauffement d’une surface. Dans une thermopile, l’effet qui est utilisé est celui qu’on retrouve dans les thermocouple : lorsqu’on porte les jonctions de deux conducteurs de nature différente reliés entre eux à des températures différentes, il apparaît aux bornes du système une différence de potentiel qui est une fonction de la différence de température (cf. figure 9).
Figure 10

Figure 11
2. Les capteurs pyroéletriques
Le principe est le même, on retrouve toujours une petite plaque noircie dont la température augmente avec l’éclairement. C’est ce qui se cache sus cette petite plaque qui change ; dans le cas des capteurs pyroéletriques, sous la plaque se trouve un matériau pyroélectrique. Ces matériaux « magiques » possèdent l’étrange propriété de se charger en surface lorsqu’on les chauffe. Les charges qui apparaissent sur les faces opposées du matériau sont de signe opposé et leur nombre est fonction de l’élévation de température. Lorsqu’on place un tel matériau dans un circuit, les charges libres du circuit se déplacent de sorte à compenser l’apparition des charges surfaciques : il apparaît un courant mesurable. La sensibilité de ce type de capteur est de l’ordre de 1kV/W et sa réponse spectrale es elle aussi relativement plate.IV. Cellules solaires et détecteurs d’images
1. Les cellules solaires
Les cellules solaires ou photopiles permettent de convertir l’énergie du rayonnement solaire et énergie électrique. Elles se présentent sous la forme de plaques de couleur sombre et ne supportent pas d’être polarisées par un générateur extérieur. Les photopiles sont constituées d’une jonction PN identique à celle des photodiodes. Cependant une photodiode est optimisée pour obtenir un courant inverse maximal sous éclairement dans un domaine spectral déterminé. Les photopiles, quant à elles sont optimisées pour fournir la puissance maximale pour u éclairement énergétique dont la distribution spectrale est celle du soleil. Les deux paramètres important pour une photopile sont : - le courant de court circuit Icc - la tension en circuit ouvert Vco Lorsqu’un photon arrive, il fait passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction. Cet électron retombe très rapidement au niveau d’énergie le plus bas de la bande de conduction, il cède alors au cristal une énergie :
 .
Quant au courant de court circuit, c’est tout simplement le produit du nombre de photon par la charge élémentaire q (chaque photon crée un électron.
Pour que tout photon du rayonnement solaire provoque l’apparition d’un électron il faut adapter la largeur du GAP. En effet, seul les photons d’énergie
.
Quant au courant de court circuit, c’est tout simplement le produit du nombre de photon par la charge élémentaire q (chaque photon crée un électron.
Pour que tout photon du rayonnement solaire provoque l’apparition d’un électron il faut adapter la largeur du GAP. En effet, seul les photons d’énergie  supérieure au GAP pourront être captés. Le spectre du soleil s’étendant de 300nm à 2,5µm, un GAP de l’ordre de 0,5eV devrait faire l’affaire. En réalité un compromis est nécessaire pour optimiser la puissance et le GAP est de l’ordre de 1 à 2eV.
supérieure au GAP pourront être captés. Le spectre du soleil s’étendant de 300nm à 2,5µm, un GAP de l’ordre de 0,5eV devrait faire l’affaire. En réalité un compromis est nécessaire pour optimiser la puissance et le GAP est de l’ordre de 1 à 2eV.
2. Les détecteurs d’image
Il est parfois utile d’étudier non plus le flux reçu en une petite surface d’un plan mais la répartition énergétique dans tout un plan, pour réaliser cette tache, nous devons faire appel aux détecteurs d’image. Le premier détecteur d’image est le film argentique, les progrès en ont fait le détecteur d’image le plus performant en terme de résolution spatiale. Cependant, l’instrumentation moderne nécessite le plus souvent des données électriques, on a donc développée des capteurs d’images électriques. Nous nous restreignons ici au cas des barrettes de photodiodes dont le fonctionnement est relativement simple. Il s’agit de circuits intégrés comportant une rangée de photodiodes auxquelles sont asociées autant de transistors (cf. figure 11).
Figure 12
I. Le cadre de l’optique géométrique
1. Description géométrique de la lumière
Plaçons une source ponctuelle derrière un écran percé d’un trou circulaire. Après l’écran, lorsqu’on déplace une feuille de papier, on observe un cercle qui devient de plus en plus gros lorsqu’on s’éloigne de l’écran percé. La lumière s’échappe ainsi par l’ouverture en suivant un cône de lumière : on parle alors de faisceau lumineux issu de l’ouverture. En s’échappant de l’ouverture, il semble alors que la lumière se propage en ligne droite. Cette propagation rectiligne se retrouve encore lorsqu’on observe la propagation de la lumière issue d’un laser. Dans un milieu homogène et isotrope , la lumière se propage en ligne droite. A la fin d’une averse, on voit souvent le soleil « percer les nuages », on voit alors les rayons du soleil descendre jusqu’au sol et réchauffer la Terre. Et c’est ainsi que l’on décrit la lumière en optique géométrique : nous dirons dans ce chapitre que la lumière est constituée d’un ensemble de lignes droites appelées « rayons lumineux ». Un faisceau lumineux est donc un ensemble de rayons lumineux rectilignes. L’objet de l’optique géométrique est de décrire la propagation de ces rayons lumineux.2. Principes fondamentaux
Reprenons l’expérience d’une source de lumière placée derrière un diaphragme. Au départ, le diaphragme possède une large ouverture, la base du cône est alors large et de nombreux rayons passent à travers l’ouverture. On rétrécit ensuite cette ouverture, certains rayons qui passaient dans le cas précédent sont maintenant arrêtés. Ceux qui passent encore n’en son absolument pas perturbé : les rayons lumineux sont indépendant les uns des autres. Reprenons maintenant une source laser, on place le laser en un point A et en B on place un miroir. Pour aller de A vers B, la lumière se propage en ligne droite, lorsqu’elle arrive en B, elle se réfléchit et repart vers A en empruntant le même chemin. Ce que nous avons remarqué sur cet exemple simple, est une réalité générale : si pour aller d’un point A vers un point B, la lumière emprunte un chemin, alors elle empruntera le même chemin pour aller de B vers A.II. Les lois de Snell-Descartes
1. Indice optique d’un milieu
Le but de l’optique géométrique, est de décrire le parcours de la lumière dans la matière en termes de rayons lumineux. Pour atteindre cet objectif, la notion essentielle est la notion d’indice optique.
L’indice optique d’un milieu est caractéristique de la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu. Dans le vide, la vitesse de propagation de la lumière est c, dans un milieu d’indice n, la lumière se déplacera à la vitesse  . L’indice optique est caractéristique du milieu.
Durant le même temps, la lumière parcourt une distance plus grande dans le vide que dans un milieu d’indice n. Le chemin optique est la distance que la lumière aurait parcouru dans le vide en le même temps qu’elle met pour aller d’un point A à un point B dans un milieu d’indice n.
. L’indice optique est caractéristique du milieu.
Durant le même temps, la lumière parcourt une distance plus grande dans le vide que dans un milieu d’indice n. Le chemin optique est la distance que la lumière aurait parcouru dans le vide en le même temps qu’elle met pour aller d’un point A à un point B dans un milieu d’indice n.
 Dans le vide,la vitesse de la lumière étant c, elle parcourt la distance :
Dans le vide,la vitesse de la lumière étant c, elle parcourt la distance :

2. Lois de Snell-Descartes
L’optique géométrique permet de décrire deux phénomènes qui interviennent dans la propagation de la lumière :
- la réflexion
- la réfraction
Ces phénomènes interviennent lorsque la lumière arrive à l’interface de deux milieux (dioptre) et sont décrits par les lois de Snell-Descartes .
Conventions
Avant d’énoncer les lois de Descartes, attachons nous un instant à mémoriser quelques conventions importantes en optique géométrique. La plupart du temps, nous aurons besoin de mesurer des angles, c’est là la première convention :
Les angles sont mesurés à partir de la normale aux surfaces
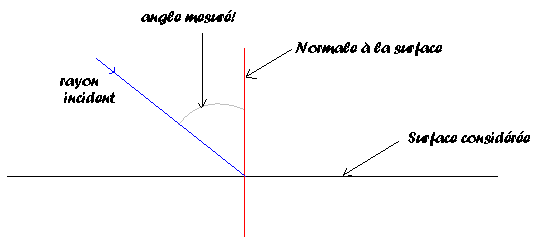 De manière générale, on considère la lumière se déplaçant de la gauche vers la droite et on établit des distances algébriques, c’est à dire qu’on pourra avoir des signes devant une distance.
Lois de la réflexion et de la réfraction
Soit le schéma suivant :
De manière générale, on considère la lumière se déplaçant de la gauche vers la droite et on établit des distances algébriques, c’est à dire qu’on pourra avoir des signes devant une distance.
Lois de la réflexion et de la réfraction
Soit le schéma suivant :
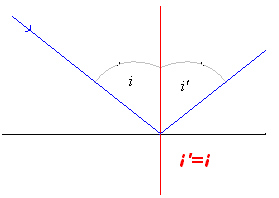 Si un rayon lumineux arrive sur une surface réfléchissante en formant un angle i avec la normale à cette surface, il sera réfléchi suivant le même angle i et dans le même plan que le rayon incident !
On retiendra les lois de la réflexion sous la forme :
Si un rayon lumineux arrive sur une surface réfléchissante en formant un angle i avec la normale à cette surface, il sera réfléchi suivant le même angle i et dans le même plan que le rayon incident !
On retiendra les lois de la réflexion sous la forme :
- angle d’incidence = angle de réflexion
- plan d’incidence = plan de réflexion
Il y a réfraction lorsque le rayon lumineux passe d’un milieu 1 à un milieu 2 avec un changement de trajectoire. La surface séparant ces deux milieux est appelée dioptre.
Dioptre : Surface transparente séparant deux milieux homogènes et transparent d’indice n et n’.
Considérons un rayon lumineux arrivant sur un dioptre avec une incidence i :
 La loi de la réfraction va nous permettre de prévoir l’angle que ce rayon formera avec la normale après la traversée du dioptre.
On considère que le milieu 1 possède un indice optique n et que le milieu 2 possède un indice n’.
La loi de la réfraction va nous permettre de prévoir l’angle que ce rayon formera avec la normale après la traversée du dioptre.
On considère que le milieu 1 possède un indice optique n et que le milieu 2 possède un indice n’.
 Les lois de la réfraction sont les suivantes :
Les lois de la réfraction sont les suivantes :
-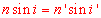
- plan réfracté = plan incident
Définition :
- si n' est supérieur à n alors que le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1
- si n' est inférieur à n alors le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1
3. Construction de Descartes
Le rayon incident arrive sur le dioptre en I , si on trace un cercle de rayon n1 et un autre de rayon n2. Le rayon incident coupe le cercle de rayon n1 en K. La perpendiculaire au dioptre passant par K coupe le cercle de rayon n2 en R’. Le segment IR’ indique alors la direction du rayon réfléchi !

4. Angle limite de réfraction
On considère le dioptre séparant un milieu d’indice n et un milieu d’indice n’ tels que n , en revanche après le dioptre il existe une valeur limite de l’angle de réfraction : c’est l’angle limite de réfraction  .
Exprimons cet angle limite de réfraction : si on considère une incidence de
.
Exprimons cet angle limite de réfraction : si on considère une incidence de  , la loi de la réfraction nous donne :
, la loi de la réfraction nous donne :
 Remarque : on fera bien attention au fait que n est inférieur à n’ sinon cela signifierai un sinus supérieur à 1 : impossible !!
Remarque : on fera bien attention au fait que n est inférieur à n’ sinon cela signifierai un sinus supérieur à 1 : impossible !!
5. Réflexion totale
Inversons le problème précédent et plaçons cette fois-ci la source lumineuse dans le milieu d’indice n’>n. l’angle d’incidence peut toujours varier entre 0 et 90°, et la loi de Descartes est toujours valable :
 En revanche il existe un angle limite au-delà duquel on n’observe plus de rayon réfracté, toute la lumière incidente est alors réfléchie, c’est le phénomène de réflexion totale. Cet angle est défini par :
En revanche il existe un angle limite au-delà duquel on n’observe plus de rayon réfracté, toute la lumière incidente est alors réfléchie, c’est le phénomène de réflexion totale. Cet angle est défini par :
 Lorsque i’est supérieur à
Lorsque i’est supérieur à  il ya réflexion totale.
il ya réflexion totale.
6. Applications
La fibre optique
Le phénomène de réflexion totale est à la base du fonctionnement des fibres optiques.
Une fibre optique à saut d’indice est constituée d’un cœur et d’une gaine. L’indice du cœur est plus élevé que celui de la gaine. Lorsqu’un rayon provenant du cœur de la fibre optique arrive sur le dioptre cœur/gaine sous un angle supérieur à l’angle limite de réfraction, il y a réflexion totale et la lumière se propage dans la fibre.
Le réfractomètre
Le réfractomètre permet la mesure de l’indice optique d’une substance. Nous allons nous restreindre ici, comme c’est généralement le cas en chimie organique, à la mesure de l’indice optique d’un liquide. La détermination de l’indice optique permet :
- d’identifier la substance
- de contrôler la pureté d’un produit
Un réfractomètre portatif peut être schématisé par la figure suivante.
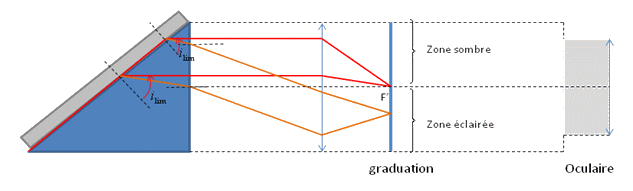 La substance d’indice ns à analyser est déposée sur la surface d’un prisme d’indice n
La substance d’indice ns à analyser est déposée sur la surface d’un prisme d’indice np proche de 1,8. Elle est éclairée via un couvercle diffusant la lumière ce qui permet d’obtenir des angles d’incidence variant de 0 à 90°.
L’indice de la substance étant plus faible que celui du prisme, on peut assister au phénomène de réfraction limite, c'est-à-dire que tous les rayons arrivant avec un angle d’incidence proche de 90° ressortent du prisme avec un angle limite ilim défini par :
 Tous les points de la surface du prisme étant éclairés par des rayons dont l’incidence varie entre 0 et 90°, on observera un ensemble de rayons émergents du prisme mais pour lesquels l’angle d’émergence possède une valeur maximale : celle qui correspond à i
Tous les points de la surface du prisme étant éclairés par des rayons dont l’incidence varie entre 0 et 90°, on observera un ensemble de rayons émergents du prisme mais pour lesquels l’angle d’émergence possède une valeur maximale : celle qui correspond à ilim .
En plaçant une lentille après le prisme, tous les rayons de même inclinaison vont converger au même point du plan focal image de cette lentille. Les rayons émergents avec l’angle limite de réfraction convergent en un point du plan focal de la lentille définissant la limite entre une zone éclairée et une zone sombre. On place alors dans ce plan une échelle graduée et transparente, puis on forme l’image de ce plan par une lentille L2 (l’oculaire). En regardant à travers l’oculaire, on voit une zone sombre et un zone éclairée et on peut ainsi lire la valeur de l’indice optique de la substance
III. Généralités sur la formation des images
1. Le but d’un instrument d’optique
Un instrument d’optique a pour but de donner d’un objet quelconque une image la plus ressemblante possible. Dans le cas idéal, on cherche donc à réaliser la correspondance entre un point de l’objet et un point de l’image. Nous verrons que cette correspondance n’est que trop rarement réalisable.
2. Définitions
Stigmatisme : On dit qu’il y a stigmatisme parfait lorsque l’image d’un point est un point. Lorsque l’image d’un point est une toute petite tache, on dit qu’il y a stigmatisme approché.
Axe optique : L’axe optique est l’axe de révolution du système optique (instrument).
Aplanétisme : On dit qu’il y a aplanétisme lorsque deux points, A et B, de l’objet appartenant à un plan perpendiculaire à l’axe optique fournissent des images A’ et B’ appartenant à un plan perpendiculaire à l’axe optique.
Source primaire : une source primaire est un objet qui produit de la lumière (exemples : soleil, ampoule)
Source secondaire : c’est un objet qui reçoit de la lumière d’une source primaire et qui la réfléchit en partie ou intégralement (arbres, tables…).
3. Images et objets
Un objet est une source primaire ou secondaire qui envoient des rayons lumineux sur le système optique ; celui-ci les dévient et des rayons lumineux ressortent de ce système optique : l’image est le point de convergence de ces rayons lumineux.
Un objet est dit réel si les rayons qui arrivent sur le système optique proviennent directement de lui. Dans le cas où ce sont les prolongements des rayons qui arrivent sur le système optique, l’objet est dit virtuel.
Une image est dite réelle si les rayons qui émergent du système optique passent effectivement par elle. Dans le cas où se sont les prolongements des rayons émergents qui passent par l’image, elle est dite virtuelle.
Objet Réel
 Objet virtuel
Objet virtuel
 Image réelle
Image réelle
 Image virtuelle
Image virtuelle
 Pour résumer :
Pour résumer :

IV. Les lentilles minces
1. Notion de lentilles minces
La lentille mince est le système optique le plus simple. Elle est formée de l’association de deux dioptres sphériques dont les sommets sont pratiquement confondus au même point.

Nous n’étudierons dans ce cours que les lentilles minces, c'est-à-dire des lentilles pour lesquelles la distance S1S2 est très petite devant le rayon de courbure des dioptres. On assimile alors la lentille à son plan : c’est le plan perpendiculaire à l’axe optique en O.
La représentation d’une lentille mince (convergente) est la suivante :

La plupart des lentilles sont réalisées en verre d’indice optique proche de 1,5.
2. Les conditions de Gauss
Les lentilles ne sont pas planes et leur indice optique est fonction de la longueur d’onde  , ces deux constatations font de l’étude des lentilles une chose délicates. Cependant il est possible de simplifier cette étude en se plaçant dans les conditions de l’approximation de Gauss :
- les rayons incidents dont faiblement inclinés sur l’axe optique
- les rayons sont proches de l’axe optique
Dans ces conditions, la majeure partie des défauts de la lentille peut être négligée. La recherche de ces conditions est donc une chose assez fréquente lorsqu’on veut réaliser l’image d’un objet : et c’est l’objet de ce cours !
, ces deux constatations font de l’étude des lentilles une chose délicates. Cependant il est possible de simplifier cette étude en se plaçant dans les conditions de l’approximation de Gauss :
- les rayons incidents dont faiblement inclinés sur l’axe optique
- les rayons sont proches de l’axe optique
Dans ces conditions, la majeure partie des défauts de la lentille peut être négligée. La recherche de ces conditions est donc une chose assez fréquente lorsqu’on veut réaliser l’image d’un objet : et c’est l’objet de ce cours !
3. Foyers et distance focale
Une lentille est caractérisée par la position de deux points :
- le foyer principal objet F
- le foyer principal image F’
Nous admettrons que ces deux points sont symétriques l’un de l’autre par rapport à O.
On définit la distance focale d’une lentille par  .
Si
.
Si  la lentille est dite convergente.
Si
la lentille est dite convergente.
Si  la lentille est dite divergente.
la lentille est dite divergente.
4. Construction d’une image
Trois rayons permettent de construire l’image d’un objet à travers une lentille.
Rayons parallèles à l’axe optique
Un rayon arrivant parallèle à l’axe optique ressort en passant par le foyer principal image

Rayons passant par le foyer principal objet
Un rayon qui passe par le foyer principal objet ressort parallèle à l’axe optique

Rayon passant par le centre
Un rayon passant par le centre optique O n’est pas dévié.

5. Relation de conjugaison
Puisqu’il faut parfois faire des calculs, on cherche une relation entre objet et image, cette relation porte le nom de relation de conjugaison.

Etude des triangles ABF et FOJ
On peut y appliquer la relation de Thalès.

Or
 et
et 
On en déduit
 (1)
(1)
Etude des triangles A’B’F’ et F’OI

Or
 et
et 
On en déduit
 (2)
(2)
En égalant les deux expressions :
 (3)
(3)
Les expressions que nous venons d’établir portent le nom de relation de Newton. C’est à partir de la dernière expression qu’on démontre la relation de conjugaison.

6. Grandissement
Le grandissement d’un système optique est donnée par

En utilisant la deuxième relation de Newton

Or en utilisant la formule de conjugaison, on obtient :

7. Objet à l’infini
On peut former à l’aide d’une lentille convergente l’image d’un objet à l’infini… mais l’infini, peut –on le voir ??
Nous allons voir que l’infini peut être bien plus proche qu’on se l’imagine.
Formons à l’aide d’une lentille convergente de distance focale f’=1m, l’image d’une tour AB de hauteur h=30m située à 3km de la lentille. La relation de conjugaison s’écrit alors :

On obtient  L’image se forme dans le plan focal image !! L’immeuble est donc situé à l’infini !
L’autre problème qui se pose est celui de la taille de l’image. La plupart du temps, on souhaite obtenir une image plus grande que celle qu’on observe à l’œil nu.
Pour préciser cette notion, on doit introduit la notion de diamètre apparent.
Un objet de hauteur AB perpendiculaire à l’axe optique et à une distance D de notre œil est vu sous un angle
L’image se forme dans le plan focal image !! L’immeuble est donc situé à l’infini !
L’autre problème qui se pose est celui de la taille de l’image. La plupart du temps, on souhaite obtenir une image plus grande que celle qu’on observe à l’œil nu.
Pour préciser cette notion, on doit introduit la notion de diamètre apparent.
Un objet de hauteur AB perpendiculaire à l’axe optique et à une distance D de notre œil est vu sous un angle


En utilisant le fait que le rayon passant par le centre n’est pas dévié, on peut écrire

Soit

Plus la distance focale est grande, plus l’image sera grande !!!
V. L’œoeil
1. Description
Le plus répandu des capteurs optiques est l’œil, c’est lui qui nous permet de voir le monde qui nous entoure. L’œil est un système optique complexe :

Les rayons lumineux entrent dans l’œil en passant à travers la cornée, l’humeur vitreuse et sont limités par la pupille. Puis le cristallin en donne une image qui se forme sur la rétine. Celle-ci est constituée de capteurs photosensibles qui transforment l’énergie lumineuse en impulsion électrique, c’est cette impulsion électrique qui est transmise au cerveau par le biais du nerf optique.
2. Modélisation
Ce capteur bien complexe peut être modélisé en travaux pratique à partir d’éléments simples :.
Le rôle de la pupille est joué par un diaphragme à ouverture variable qui permet à l’œil de travailler dans les conditions de Gauss.
Le cristallin est modélisé par une lentille. En réalité le cristallin est une lentille dont la distance focale peut varier sous l’action des muscles de l’œil.
La rétine peut se modéliser par un écran dépoli.
3. Les problèmes de vue
Un œil normal est un œil qui voit distinctement des objets à l’infini. Dans cette configuration l’œil travaille sans fatigue car les muscles de l’œil sont décontractés, la distance cristallin rétine est alors égale à la distance focale du cristallin ( 25mm).
Le cristallin peut ajuster sa distance focale mais pas de manière indéfinie, il existe une limite à cette accommodation. Le punctum proximum en est une manifestation : il s’agit de la distance la plus faible de vision distincte. Pour un œil normal il est situé à 25cm de l’œil.
Le plus grande distance visible par l’œil correspond à la position du punctum remotum, pour l’œil normal il est à l’infini.
Un œil est dit myope si le cristallin est trop convergent, son punctum remotum est à distance finie et le punctum proximum est plus près de l’œil. On corrige ce défaut par des lentilles divergentes.
Un œil est dit hypermétrope si le cristallin n’est pas assez convergent, le punctum remotum se situe alors plus loin de l’œil. On corrige ce défaut par des lentilles convergentes.
Un œil est dit astigmate s’il ne possède pas la symétrie de révolution. On corrige ce défaut par des lentilles cylindriques.
Avec l’âge, la capacité d’accommodation de l’œil diminue et le Punctum Proximum s’éloigne : c’est la presbytie.
VI. Instruments d’optique
1. Généralités
Un instrument d’optique est destiné à améliorer la vision que nous pouvons avoir d’un objet à l’œil nu. Il s’agit souvent d’examiner des détails invisibles à l’œil nu : c’est le cas de la loupe, du microscope, de la lunette astronomique et des instruments de projection.
Les instruments d’optiques sont nombreux, le but, ici, n’est pas d’en faire une description systématique mais de donner les principes généraux des instruments les plus utilisés (surtout en chimie).
D’une manière générale, les instruments d’optiques doivent permettre à l’utilisateur d’observer les détails voulus sans se fatiguer c'est-à-dire sans que l’œil ne fatigue. L’œil ne doit pas accommoder en regardant à travers un instrument : l’image doit donc se former à l’infini.
2. Le collimateur
Le collimateur est un instrument de laboratoire destiné à procurer l’équivalent d’un objet à l’infini. Il se compose d’un premier objet (trou, réticule, mire) éclairé par une source lumineuse et situé dans le plan focal objet d’une lentille convergente. Cette lentille donne de cet objet une image à l’infini qui pourra elle-même servir d’objet pour un autre dispositif.
3. L’objectif
C’est le premier élément d’un instrument d’optique, c’est lui qui reçoit les rayons lumineux issus de l’objet à analyser. Il forme une image intermédiaire de l’objet qui sert ensuite d’objet à l’oculaire par exemple.
4. L’oculaire
Un oculaire est une lentille mince (ou le plus souvent un doublet de lentilles). L’oculaire est en général la dernière pièce d’un instrument d’optique, c’est lui qui permet de voir dans de bonnes conditions. L’oculaire sert donc à voir l’image intermédiaire qui est formé par un système optique.
 .
Exprimons cet angle limite de réfraction : si on considère une incidence de
.
Exprimons cet angle limite de réfraction : si on considère une incidence de  , la loi de la réfraction nous donne :
, la loi de la réfraction nous donne :
 Remarque : on fera bien attention au fait que n est inférieur à n’ sinon cela signifierai un sinus supérieur à 1 : impossible !!
Remarque : on fera bien attention au fait que n est inférieur à n’ sinon cela signifierai un sinus supérieur à 1 : impossible !!
5. Réflexion totale
Inversons le problème précédent et plaçons cette fois-ci la source lumineuse dans le milieu d’indice n’>n. l’angle d’incidence peut toujours varier entre 0 et 90°, et la loi de Descartes est toujours valable : En revanche il existe un angle limite au-delà duquel on n’observe plus de rayon réfracté, toute la lumière incidente est alors réfléchie, c’est le phénomène de réflexion totale. Cet angle est défini par :
En revanche il existe un angle limite au-delà duquel on n’observe plus de rayon réfracté, toute la lumière incidente est alors réfléchie, c’est le phénomène de réflexion totale. Cet angle est défini par :
 Lorsque i’est supérieur à
Lorsque i’est supérieur à  il ya réflexion totale.
il ya réflexion totale.
6. Applications
La fibre optique Le phénomène de réflexion totale est à la base du fonctionnement des fibres optiques. Une fibre optique à saut d’indice est constituée d’un cœur et d’une gaine. L’indice du cœur est plus élevé que celui de la gaine. Lorsqu’un rayon provenant du cœur de la fibre optique arrive sur le dioptre cœur/gaine sous un angle supérieur à l’angle limite de réfraction, il y a réflexion totale et la lumière se propage dans la fibre. Le réfractomètre Le réfractomètre permet la mesure de l’indice optique d’une substance. Nous allons nous restreindre ici, comme c’est généralement le cas en chimie organique, à la mesure de l’indice optique d’un liquide. La détermination de l’indice optique permet :- d’identifier la substance
- de contrôler la pureté d’un produit
Un réfractomètre portatif peut être schématisé par la figure suivante.
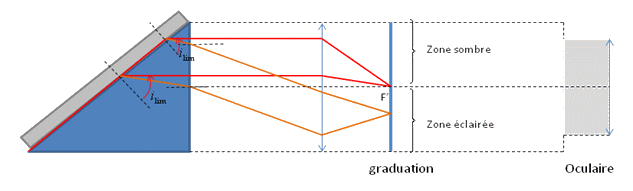 La substance d’indice ns à analyser est déposée sur la surface d’un prisme d’indice n
La substance d’indice ns à analyser est déposée sur la surface d’un prisme d’indice n Tous les points de la surface du prisme étant éclairés par des rayons dont l’incidence varie entre 0 et 90°, on observera un ensemble de rayons émergents du prisme mais pour lesquels l’angle d’émergence possède une valeur maximale : celle qui correspond à i
Tous les points de la surface du prisme étant éclairés par des rayons dont l’incidence varie entre 0 et 90°, on observera un ensemble de rayons émergents du prisme mais pour lesquels l’angle d’émergence possède une valeur maximale : celle qui correspond à iIII. Généralités sur la formation des images
1. Le but d’un instrument d’optique
Un instrument d’optique a pour but de donner d’un objet quelconque une image la plus ressemblante possible. Dans le cas idéal, on cherche donc à réaliser la correspondance entre un point de l’objet et un point de l’image. Nous verrons que cette correspondance n’est que trop rarement réalisable.2. Définitions
Stigmatisme : On dit qu’il y a stigmatisme parfait lorsque l’image d’un point est un point. Lorsque l’image d’un point est une toute petite tache, on dit qu’il y a stigmatisme approché. Axe optique : L’axe optique est l’axe de révolution du système optique (instrument). Aplanétisme : On dit qu’il y a aplanétisme lorsque deux points, A et B, de l’objet appartenant à un plan perpendiculaire à l’axe optique fournissent des images A’ et B’ appartenant à un plan perpendiculaire à l’axe optique. Source primaire : une source primaire est un objet qui produit de la lumière (exemples : soleil, ampoule) Source secondaire : c’est un objet qui reçoit de la lumière d’une source primaire et qui la réfléchit en partie ou intégralement (arbres, tables…).3. Images et objets
Un objet est une source primaire ou secondaire qui envoient des rayons lumineux sur le système optique ; celui-ci les dévient et des rayons lumineux ressortent de ce système optique : l’image est le point de convergence de ces rayons lumineux. Un objet est dit réel si les rayons qui arrivent sur le système optique proviennent directement de lui. Dans le cas où ce sont les prolongements des rayons qui arrivent sur le système optique, l’objet est dit virtuel. Une image est dite réelle si les rayons qui émergent du système optique passent effectivement par elle. Dans le cas où se sont les prolongements des rayons émergents qui passent par l’image, elle est dite virtuelle. Objet Réel Objet virtuel
Objet virtuel
 Image réelle
Image réelle
 Image virtuelle
Image virtuelle
 Pour résumer :
Pour résumer :

IV. Les lentilles minces
1. Notion de lentilles minces
La lentille mince est le système optique le plus simple. Elle est formée de l’association de deux dioptres sphériques dont les sommets sont pratiquement confondus au même point.

2. Les conditions de Gauss
Les lentilles ne sont pas planes et leur indice optique est fonction de la longueur d’onde , ces deux constatations font de l’étude des lentilles une chose délicates. Cependant il est possible de simplifier cette étude en se plaçant dans les conditions de l’approximation de Gauss :
- les rayons incidents dont faiblement inclinés sur l’axe optique
- les rayons sont proches de l’axe optique
Dans ces conditions, la majeure partie des défauts de la lentille peut être négligée. La recherche de ces conditions est donc une chose assez fréquente lorsqu’on veut réaliser l’image d’un objet : et c’est l’objet de ce cours !
, ces deux constatations font de l’étude des lentilles une chose délicates. Cependant il est possible de simplifier cette étude en se plaçant dans les conditions de l’approximation de Gauss :
- les rayons incidents dont faiblement inclinés sur l’axe optique
- les rayons sont proches de l’axe optique
Dans ces conditions, la majeure partie des défauts de la lentille peut être négligée. La recherche de ces conditions est donc une chose assez fréquente lorsqu’on veut réaliser l’image d’un objet : et c’est l’objet de ce cours !
3. Foyers et distance focale
Une lentille est caractérisée par la position de deux points : - le foyer principal objet F - le foyer principal image F’ Nous admettrons que ces deux points sont symétriques l’un de l’autre par rapport à O. On définit la distance focale d’une lentille par .
Si
.
Si  la lentille est dite convergente.
Si
la lentille est dite convergente.
Si  la lentille est dite divergente.
la lentille est dite divergente.
4. Construction d’une image
Trois rayons permettent de construire l’image d’un objet à travers une lentille. Rayons parallèles à l’axe optique Un rayon arrivant parallèle à l’axe optique ressort en passant par le foyer principal image


5. Relation de conjugaison
Puisqu’il faut parfois faire des calculs, on cherche une relation entre objet et image, cette relation porte le nom de relation de conjugaison.
Etude des triangles ABF et FOJ
On peut y appliquer la relation de Thalès.
 et
et 
 (1)
(1)
Etude des triangles A’B’F’ et F’OI

 et
et 
 (2)
(2)
 (3)
(3)

6. Grandissement
Le grandissement d’un système optique est donnée par


7. Objet à l’infini
On peut former à l’aide d’une lentille convergente l’image d’un objet à l’infini… mais l’infini, peut –on le voir ?? Nous allons voir que l’infini peut être bien plus proche qu’on se l’imagine. Formons à l’aide d’une lentille convergente de distance focale f’=1m, l’image d’une tour AB de hauteur h=30m située à 3km de la lentille. La relation de conjugaison s’écrit alors :
 L’image se forme dans le plan focal image !! L’immeuble est donc situé à l’infini !
L’autre problème qui se pose est celui de la taille de l’image. La plupart du temps, on souhaite obtenir une image plus grande que celle qu’on observe à l’œil nu.
Pour préciser cette notion, on doit introduit la notion de diamètre apparent.
Un objet de hauteur AB perpendiculaire à l’axe optique et à une distance D de notre œil est vu sous un angle
L’image se forme dans le plan focal image !! L’immeuble est donc situé à l’infini !
L’autre problème qui se pose est celui de la taille de l’image. La plupart du temps, on souhaite obtenir une image plus grande que celle qu’on observe à l’œil nu.
Pour préciser cette notion, on doit introduit la notion de diamètre apparent.
Un objet de hauteur AB perpendiculaire à l’axe optique et à une distance D de notre œil est vu sous un angle




V. L’œoeil
1. Description
Le plus répandu des capteurs optiques est l’œil, c’est lui qui nous permet de voir le monde qui nous entoure. L’œil est un système optique complexe :
2. Modélisation
Ce capteur bien complexe peut être modélisé en travaux pratique à partir d’éléments simples :. Le rôle de la pupille est joué par un diaphragme à ouverture variable qui permet à l’œil de travailler dans les conditions de Gauss. Le cristallin est modélisé par une lentille. En réalité le cristallin est une lentille dont la distance focale peut varier sous l’action des muscles de l’œil. La rétine peut se modéliser par un écran dépoli.3. Les problèmes de vue
Un œil normal est un œil qui voit distinctement des objets à l’infini. Dans cette configuration l’œil travaille sans fatigue car les muscles de l’œil sont décontractés, la distance cristallin rétine est alors égale à la distance focale du cristallin ( 25mm). Le cristallin peut ajuster sa distance focale mais pas de manière indéfinie, il existe une limite à cette accommodation. Le punctum proximum en est une manifestation : il s’agit de la distance la plus faible de vision distincte. Pour un œil normal il est situé à 25cm de l’œil. Le plus grande distance visible par l’œil correspond à la position du punctum remotum, pour l’œil normal il est à l’infini. Un œil est dit myope si le cristallin est trop convergent, son punctum remotum est à distance finie et le punctum proximum est plus près de l’œil. On corrige ce défaut par des lentilles divergentes. Un œil est dit hypermétrope si le cristallin n’est pas assez convergent, le punctum remotum se situe alors plus loin de l’œil. On corrige ce défaut par des lentilles convergentes. Un œil est dit astigmate s’il ne possède pas la symétrie de révolution. On corrige ce défaut par des lentilles cylindriques. Avec l’âge, la capacité d’accommodation de l’œil diminue et le Punctum Proximum s’éloigne : c’est la presbytie.VI. Instruments d’optique
1. Généralités
Un instrument d’optique est destiné à améliorer la vision que nous pouvons avoir d’un objet à l’œil nu. Il s’agit souvent d’examiner des détails invisibles à l’œil nu : c’est le cas de la loupe, du microscope, de la lunette astronomique et des instruments de projection. Les instruments d’optiques sont nombreux, le but, ici, n’est pas d’en faire une description systématique mais de donner les principes généraux des instruments les plus utilisés (surtout en chimie). D’une manière générale, les instruments d’optiques doivent permettre à l’utilisateur d’observer les détails voulus sans se fatiguer c'est-à-dire sans que l’œil ne fatigue. L’œil ne doit pas accommoder en regardant à travers un instrument : l’image doit donc se former à l’infini.2. Le collimateur
Le collimateur est un instrument de laboratoire destiné à procurer l’équivalent d’un objet à l’infini. Il se compose d’un premier objet (trou, réticule, mire) éclairé par une source lumineuse et situé dans le plan focal objet d’une lentille convergente. Cette lentille donne de cet objet une image à l’infini qui pourra elle-même servir d’objet pour un autre dispositif.3. L’objectif
C’est le premier élément d’un instrument d’optique, c’est lui qui reçoit les rayons lumineux issus de l’objet à analyser. Il forme une image intermédiaire de l’objet qui sert ensuite d’objet à l’oculaire par exemple.4. L’oculaire
Un oculaire est une lentille mince (ou le plus souvent un doublet de lentilles). L’oculaire est en général la dernière pièce d’un instrument d’optique, c’est lui qui permet de voir dans de bonnes conditions. L’oculaire sert donc à voir l’image intermédiaire qui est formé par un système optique.I. La lumière
1. Une onde électromagnétique
La lumière est une onde électromagnétique, elle se compose d’un champ électrique et d’un champ magnétique évoluant dans le temps. Cette onde est une onde transversale, de ce fait le vecteur champ électrique et champ magnétique sont perpendiculaires à la direction de propagation. Cette description du champ magnétique due à Maxwell apporte deux éléments nouveaux pour vous et qui méritent toute notre attention : - La lumière est constituée de vecteurs, or ces objets mathématiques ont certaines particularités qui vont se répercuter sur les propriétés de la lumière - La lumière est une onde tout comme le son ou les rides à la surface de l’eau, elle est régie par les mêmes lois et nous devrions observer les mêmes phénomènes tels que la diffraction. C’est donc sur ces deux aspects que nous allons nous attarder dans ce chapitre. Nous poserons tout de même une simplification, la lumière qui nous entoure est une superposition complexe de longueur d’onde et de surface d’onde sphériques et planes mais nous nous limiterons à l’étude d’onde plane monochromatique. Cette simplification se justifie parle théorème de Fourier qui postule que toute onde peut être écrite comme une somme continue d’onde plane monochromatique, en étudier une permet donc de les étudier toutes !2. Les « grains » de lumière
Une autre théorie de la lumière postule qu’elle est constituée de particules sans masse transportant avec elles une énergie fonction de la longueur d’onde associée à la lumière : les photons. Dans cette représentation la lumière interagit avec la matière au travers de chocs entre particules (effet Compton, photoélectrique). Elle est très pratique pour expliquer le fonctionnement de certains capteurs de flux lumineux comme nous allons le voir dans un prochain chapitre mais pour expliquer la notion de polarisation ou de diffraction à partir de cette vision des choses, il faut faire appel à la mécanique quantique, et cela dépasse de loin le cadre de ce cours…II. Polarisation : Conséquence du caractère vectoriel de la lumière
1. Définition
Intéressons nous au cas simple d’une onde plane monochromatique se propageant suivant l’axe des x. La description de la lumière passe alors par la description du champ électrique, le champ magnétique se déduisant de celui-ci . Dans le cas le plus général, le champ électrique possède une composante suivant l’axe Oy et une composante suivant l’axe Oz. On peut donc écrire :

 Le champ électrique est constitué de deux vibrations perpendiculaires qui oscillent autour de 0 avec un déphasage.
Etudier la polarisation de la lumière c’est étudier l’évolution du vecteur champ électrique au cours du temps. Cette évolution est fonction du déphasage entre les deux composantes du vecteur champ électrique.
Remarque : Le plan de polarisation est, dans un milieu isotrope, le plan défini par la direction de propagation du rayon lumineux (donc
Le champ électrique est constitué de deux vibrations perpendiculaires qui oscillent autour de 0 avec un déphasage.
Etudier la polarisation de la lumière c’est étudier l’évolution du vecteur champ électrique au cours du temps. Cette évolution est fonction du déphasage entre les deux composantes du vecteur champ électrique.
Remarque : Le plan de polarisation est, dans un milieu isotrope, le plan défini par la direction de propagation du rayon lumineux (donc  ) et la direction du champ électrique.
) et la direction du champ électrique.
2. Les états de polarisation
Comme nous l’avons dit précédemment, l’état de polarisation de l’onde plane monochromatique que nous sommes en train de décrire est fonction du déphasage entre les composantes selon Oz et Oy du vecteur champ électrique. Nous allons donc étudier certains cas particuliers.
Les composantes sont en phase
entre les composantes selon Oz et Oy du vecteur champ électrique. Nous allons donc étudier certains cas particuliers.
Les composantes sont en phase  Lorsque les deux vibrations sont en phase, le vecteur
Lorsque les deux vibrations sont en phase, le vecteur  résultant garde une direction fixe suivant laquelle il oscille : la polarisation est alors rectiligne.
résultant garde une direction fixe suivant laquelle il oscille : la polarisation est alors rectiligne.

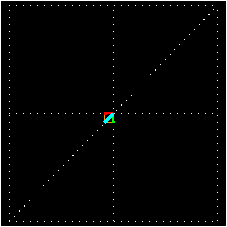 Les composantes sont en opposition de phase
Les composantes sont en opposition de phase  Lorsque les vibrations sont en opposition de phase, le résultat est le même, le vecteur
Lorsque les vibrations sont en opposition de phase, le résultat est le même, le vecteur  garde une direction fixe (perpendiculaire à la précédente) : la polarisation est encore rectiligne
Les composantes sont déphasées
Lorsque le déphasage
garde une direction fixe (perpendiculaire à la précédente) : la polarisation est encore rectiligne
Les composantes sont déphasées
Lorsque le déphasage  est quelconque, le vecteur décrit une ellipse : la polarisation est dite elliptique. Lorsque cette ellipse est parcourue dans le sens trigonométrique : la polarisation est dite gauche. Lorsqu’elle est parcourue dans le sens des aiguilles d’une montre, la polarisation est dite droite.
On peut résumer ces résultats à l’aide du tableau de la figure 1.
est quelconque, le vecteur décrit une ellipse : la polarisation est dite elliptique. Lorsque cette ellipse est parcourue dans le sens trigonométrique : la polarisation est dite gauche. Lorsqu’elle est parcourue dans le sens des aiguilles d’une montre, la polarisation est dite droite.
On peut résumer ces résultats à l’aide du tableau de la figure 1.
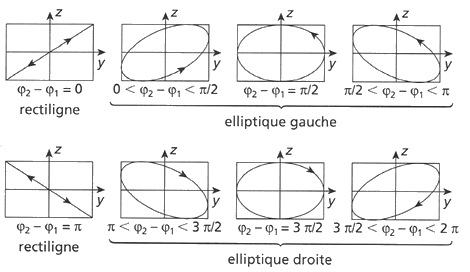
3. Lumière naturelle et Polarisation de la lumière
La lumière naturelle, elle qui est produite par une ampoule ou celle qui provient du soleil n’est en général pas polarisée. Ceci s’explique toujours à l’aide du déphasage , celui-ci est parfaitement aléatoire dans le cas de la lumière naturelle, de ce fait la lumière naturelle est une superposition de tous les états de polarisations que nous avons décrites précédemment : on dit qu’elle n’est pas polarisée. La lumière naturelle n’est pas polarisée.
La lumière naturelle par excellence est celle provenant du soleil, celle là n’est absolument pas polarisée, en revanche la lumière qui nous parvient à chaque instant n’est plus tout à fait naturelle, elle a été polarisée. Un certain nombre de phénomènes sont capables de polariser la lumière naturelle, par exemple, lorsque la lumière se réfléchit sur une vitre, elle se polarise partiellement. Lorsqu’elle traverse des particules en suspension, elle se polarise un peu aussi. Mais ces phénomènes n’aboutissent que très rarement à la polarisation complète de la lumière et elle ets finalement partiellement polarisée. Lorsque la lumière est un mélange de lumière naturelle et de lumière polarisée, on dit qu’elle est partiellement polarisée.
Imaginons maintenant que nous parvenions à faire subir de multiples réflexions à un faisceau de lumière naturelle peut-être finirait-elle par être entièrement polarisée ? Ce passage d’une lumière non polarisée ou partiellement polarisée à une lumière ayant une polarisation particulière est assurée par un polariseur.
, celui-ci est parfaitement aléatoire dans le cas de la lumière naturelle, de ce fait la lumière naturelle est une superposition de tous les états de polarisations que nous avons décrites précédemment : on dit qu’elle n’est pas polarisée. La lumière naturelle n’est pas polarisée.
La lumière naturelle par excellence est celle provenant du soleil, celle là n’est absolument pas polarisée, en revanche la lumière qui nous parvient à chaque instant n’est plus tout à fait naturelle, elle a été polarisée. Un certain nombre de phénomènes sont capables de polariser la lumière naturelle, par exemple, lorsque la lumière se réfléchit sur une vitre, elle se polarise partiellement. Lorsqu’elle traverse des particules en suspension, elle se polarise un peu aussi. Mais ces phénomènes n’aboutissent que très rarement à la polarisation complète de la lumière et elle ets finalement partiellement polarisée. Lorsque la lumière est un mélange de lumière naturelle et de lumière polarisée, on dit qu’elle est partiellement polarisée.
Imaginons maintenant que nous parvenions à faire subir de multiples réflexions à un faisceau de lumière naturelle peut-être finirait-elle par être entièrement polarisée ? Ce passage d’une lumière non polarisée ou partiellement polarisée à une lumière ayant une polarisation particulière est assurée par un polariseur.
4. Entre polariseur et analyseur
Les polariseurs les plus courants sont constitués de polymères alignés les uns à coté des autres dans une direction donnée. Sur ces polymères sont rattachées des molécules de colorant capables d’absorber la lumière. L’absorption de la lumière ne se fait que dans une direction donnée si bien que ces polariseurs sont capables d’éteindre une des composantes du champ électrique (suivant Oy ou suivant Ox). En conclusion un polariseur transforme une lumière de polarisation quelconque en lumière de polarisation rectiligne. C’est donc un moyen « artificiel » de produire de la lumière polarisée. 

 est l’angle entre la direction du polariseur et celle de l’analyseur
est l’angle entre la direction du polariseur et celle de l’analyseur

5. Substance optiquement active
La polarisation est une caractéristique peu connue de la lumière et pour cause, elle est invariante lors de la traversée de la plupart des milieux ; la plupart mais pas tous… Certaines substances sont capables de faire tourner la direction de polarisation du champ électrique (ou plus généralement le plan de polarisation de la lumière): ce sont les substances optiquement actives. Chaque substance est caractérisée par son pouvoir rotatoire spécifique, il est caractéristique de la capacité d’une substance à faire tourner la direction de polarisation de la lumière. Le pouvoir rotatoire spécifique représente l’angle dont tourne la direction de polarisation du champ après la traversée de 1dm de solution optiquement active de concentration 1g/L. Au même titre que le point d’ébullition ou l’indice optique le pouvoir rotatoire spécifique constitue une carte d’identité de la substance. Après la traversée d’une distance l de solution de concentration c, langle dont a tourné la direction de polarisation du vecteur est donné par la loi de Biot :- (
 ) pouvoir rotatoire spécifique
) pouvoir rotatoire spécifique -
 pouvoir rotatoire de la solution
pouvoir rotatoire de la solution - l longueur de la cuve en dm
- c concentration massique en g/L
- n
D pour la polarisation circulaire droite - n
g pour la polarisation circulaire gauche

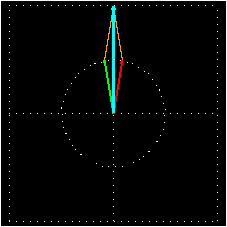
Le chemin optique parcouru par chaque composante est donc différent, il en résulte un déphasage à la sortie et une rotation du vecteur électrique. Cette activité optique ne peut être le fruit que d’une brisure de la symétrie droite-gauche, par conséquent une substance optiquement active est une substance chirale. A titre d’exemples voici le pouvoir rotatoire spécifique de quelques substances

6. Le polarimètre de Laurent
La loi de Biot est très intéressante pour un chimiste, en effet moyennant la connaissance du pouvoir rotatoire spécifique d’une substance, la mesure de l’angle dont a tourné la direction de polarisation du champ électrique après la traversée d’une cuve de longueur connue permet de déterminer la concentration. Le tout c’est de mesurer l’angle a !! D’un point de vue purement théorique il suffirait de réaliser le montage suivant : 
- Une lampe spectrale au sodium pour source lumineuse
- Un polariseur qui produit une lumière polarisée rectilignement et dont la direction de polarisation fait un angle beta avec la verticale.
- Une lame demi-onde qui occupe la partie inférieure du cylindre et qui est capable de transformer une polarisation rectiligne en une autre polarisation rectiligne symétrique par rapport à la première
- Une cuve à échantillon dont la longueur est généralement de 1dm
- Un analyseur Commençons par voir ce qui se passe si il n’ya a pas de cuve à échantillon. Tout d’abord, le polariseur produit une lumière polarisée rectilignement et formant un angle ß avec la verticale (rouge). Vient ensuite la lame demi-onde qui transforme la partie inférieure du faisceau lumineux en une lumière polarisée rectilignement et dont la direction de polarisation forme un angle –ß avec la verticale (bleue). Si on veut obtenir le même éclairement sur l’écran il faut que les angles entre l’analyseur et chacune des directions de polarisation soient les mêmes : l’analyseur peut être vertical ou horizontal (l’angle entre la direction de l’analyseur et la direction de polarisation de la lumière n’ayant pas traversé la lame retard (rouge) doit être égal à l’angle entre la direction de l’analyseur et la direction de polarisation de la lumière ayant traversée la lame retard (bleue)). Si cet angle est petit (analyseur en position 1, vertical) comme représenté sur le schéma ci-dessous, le cosinus sera grand et l’intensité lumineuse grande (Loi de Malus) et ce n’est pas souhaitable pour des raisons de précisions identiques à celles qui nous ont amenées au polarimètre de Laurent.


 et dans le même sens comme indiqué par la figure ci-dessous.
et dans le même sens comme indiqué par la figure ci-dessous.

 et 360+
et 360+ !
!
III. Nature ondulatoire de la lumière : interférence et diffraction
1. Résultats expérimentaux
Lorsqu’on s’arrête à une station essence pour faire le plein, il n’est pas rare de voir sur le sol des taches de carburant. Lorsque la lumière du soleil vient frapper cette pollution, il apparait alors à la surface des taches de gasoil des couleurs, comme sur un arc en ciel. Ce phénomène est due au caractère ondulatoire de la lumière et porte le nom d’interférence. L’ensemble des couleurs qu’on observe dans ce phénomène est due à la lumière du soleil. On peut réaliser des expériences d’interférence à l’aide de source monochromatique et on aboutit alors à un résultat stupéfiant : L’addition de deux sources lumineuses peut aboutir à des zones d’ombres come le montre la figure ci-dessous. 
2. Notion d’interférence
Commençons par étudier le cas le plus simple et considérons deux sources ponctuelles monochromatiques fournissant une onde lumineuse de même polarisation et de même pulsation. Le champ électrique associé à chaque source s’écrit donc au point M de la manière suivante : - pour S1 

 (1)
(1)
 (2)
(2)
 (3)
(3)


 (4)
(4)









 fois le chemin optique.
Ce résultat peut nous aider à expliciter le terme d’interférences
fois le chemin optique.
Ce résultat peut nous aider à expliciter le terme d’interférences . Il intervient dans ce terme une différence de phase
. Il intervient dans ce terme une différence de phase  , on peut exprimer cette différence de phase en fonction du chemin optique :
, on peut exprimer cette différence de phase en fonction du chemin optique :

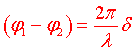
 est la différence de marche entre les rayons issus de S1 et ceux issu de S2. L’intensité résultante de l’interférence de sources ponctuelles monochromatiques s’écrira finalement :
est la différence de marche entre les rayons issus de S1 et ceux issu de S2. L’intensité résultante de l’interférence de sources ponctuelles monochromatiques s’écrira finalement :

3. Condition d’obtention des interférences
Si deux sources ponctuelles monochromatique et de même polarisation sont placées en deux points distinct de l’espace S1 et S2, l’intensité lumineuse en un point M est donnée par :

 mais les trains d’ondes ayant des phases à l’origine totalement aléatoire cette moyenne est nulle ! Ces quelques phrases suffisent à expliquer l’impossibilité d’obtenir des interférences avec les ampoules d’une salle. En conclusion, il faudra donc retenir qu’avant de transformer une salle de séjour en véritable laboratoire scientifique il vaut peut être mieux se pencher sur les hypothèses qui nous ont permis d’obtenir les relations qu’on cherche à appliquer.
Revenons maintenant à nos interférences. Comment peut-on obtenir des interférences puisqu’on ne peut pas utiliser deux sources distinctes ? La réponse est dans la question : il faut utiliser une seule source et créer à partir de cette source deux sources secondaires, ces sources secondaires sont dites cohérentes.
mais les trains d’ondes ayant des phases à l’origine totalement aléatoire cette moyenne est nulle ! Ces quelques phrases suffisent à expliquer l’impossibilité d’obtenir des interférences avec les ampoules d’une salle. En conclusion, il faudra donc retenir qu’avant de transformer une salle de séjour en véritable laboratoire scientifique il vaut peut être mieux se pencher sur les hypothèses qui nous ont permis d’obtenir les relations qu’on cherche à appliquer.
Revenons maintenant à nos interférences. Comment peut-on obtenir des interférences puisqu’on ne peut pas utiliser deux sources distinctes ? La réponse est dans la question : il faut utiliser une seule source et créer à partir de cette source deux sources secondaires, ces sources secondaires sont dites cohérentes.
4. Dispositifs interférentiels
Pour obtenir des interférences, il faut à partir d’une source créer deux sources secondaires distinctes. Il existe deux possibilités pour créer ces sources : - la division d’amplitude, qui consiste à séparer l’énergie lumineuse issue de la source primaire en deux faisceaux d’énergie égale. Cette division est la plupart du temps réalisé à l’aide d’une lame semi transparente. - la division du front d’onde qui consiste tout simplement à diviser une surface d’onde, pour cela on place devant la source un objet percé de deux très petites ouvertures, ces ouvertures deviennent les sources secondaires.5. Interféromètre de Michelson
Description Le dispositif à division d’amplitude le plus courant est l’interféromètre de Michelson. Nous n’étudierons ici qu’un cas particulier d’utilisation de cet interféromètre, celui qui est utilisé dans les spectroscopes à transformée de Fourier. Le schéma simplifié d’un Michelson est le suivant :









 ne dépend que de l’angle d’incidence, c’est pourquoi on appelle ces interférences, interférences d’égales inclinaisons. En sortie du Michelson, l’intensité ne dépend aussi que de l’angle, on observera donc des anneaux d’interférences.
On peut montrer que le rayon du kème anneau est donné par :
ne dépend que de l’angle d’incidence, c’est pourquoi on appelle ces interférences, interférences d’égales inclinaisons. En sortie du Michelson, l’intensité ne dépend aussi que de l’angle, on observera donc des anneaux d’interférences.
On peut montrer que le rayon du kème anneau est donné par :

 la longueur d’onde de la source monochromatique
la longueur d’onde de la source monochromatique
6. Les fentes d’Young
C’est le dispositif à division de front d’onde le plus courant. Une source ponctuelle S éclaire u écran opaque percé de deux trous. D’après les lois de l’optique géométrique, o s’attend à obtenir l’image de ces deux trous sur l’écran, en réalité, la diffraction intervient si bien qu’on obtient des faisceaux qui se recouvrent. La zone de recouvrement est appelée zone d’interférence.

 .
Dans la pratique, on observe les interférences sur un écran placé à une distance D>>a. calculons pour un point M de cet écran la différence de marche
.
Dans la pratique, on observe les interférences sur un écran placé à une distance D>>a. calculons pour un point M de cet écran la différence de marche  .
.

 exprimons chacune de ces longueurs.
En appliquant la relation de Pythagore :
exprimons chacune de ces longueurs.
En appliquant la relation de Pythagore :



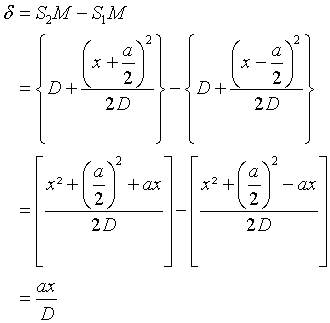

7. Généralités sur la diffraction
Réalisons la petite expérience suivante illustrée par la figure ci-dessous.



 et sont beaucoup moins intense, on vérifie bien, ici, que la majeure partie de l’intensité lumineuse correspond à l’image géométrique. La position des franges sombres est aisément calculable étant donné qu’elles s’obtiennent pour
et sont beaucoup moins intense, on vérifie bien, ici, que la majeure partie de l’intensité lumineuse correspond à l’image géométrique. La position des franges sombres est aisément calculable étant donné qu’elles s’obtiennent pour  soit
soit  . On en déduit finalement que les franges sombres sont obtenues pour :
. On en déduit finalement que les franges sombres sont obtenues pour :

I. Caractéristiques d’une source lumineuse
1. Spectre d’une source
Dans les années 1670 Sir Isaac Newton étudia la lumière du soleil et s’aperçut qu’il pouvait décomposer cette lumière blanche en une multitude de couleurs. Cette expérience, réalisée à l’aide d’un prisme, permis à Newton de comprendre que la lumière blanche n’est autre qu’une superposition de plusieurs ondes monochromatiques. Cette notion lui permis d’introduire le concept de spectre lumineux (ou spectre électromagnétique). Décrire la répartition de l’énergie lumineuse en fonction de la fréquence c’est décrire le spectre de la lumière. Chaque source lumineuse possède un spectre qui lui est propre, elle émet plus ou moins d’énergie à telle ou telle longueur d’onde. Lorsqu’une source émet de l’énergie à chaque longueur d’onde, on dit que son spectre est continu. Lorsqu’une source n’émet de l’énergie qu’à certaines longueurs d’onde bien définies, on dit que le spectre est discontinu. On peut diviser le spectre en différentes régions :- Infra rouge, qui est le domaine des rayonnements peu énergétiques principalement utilisées en spectroscopie et pour la transmission de signaux à faible distances (télécommandes)
- Visible, c’est le domaine qui nous est le plus familier car c’est aux rayonnement de ce domaine que notre œil est sensible, sans source de rayonnement visible, nous serions tous plongés dans le noir -
- Ultraviolet, qui est un domaine de rayonnement énergétique, le soleil en émet une bonne partie bien heureusement arrêtée par la couche d’ozone. Outre son caractère potentiellement dangereux les chimistes en ont fait une méthode d’analyse des plus répandue
- Rayons X et gamma, Encore plus dangereux que les U.V ils sont émis par certaines sources radioactives, ou sont fabriquées par l’homme à des fins analytiques.
 Figure 1 : Domaines Spectraux
Figure 1 : Domaines Spectraux
2. Dimension spatiale d’une source
Une autre caractéristique importante des sources lumineuses est leur dimension spatiale. En effet, il serait saugrenu de vouloir éclairer une pièce avec un laser plutôt qu’avec une lampe à incandescence ! Lorsqu’une source lumineuse est large, c'est-à-dire qu’il existe une multitude de points de l’espace émettant de la lumière, on dit que cette source est étendue (elle permet alors d’éclairer une grande surface au dépend de l’intensité). Lorsqu’une source n’est composé que d’un nombre restreint de points lumineux proches les uns des autres, on dit qu’elle est ponctuelle (quasi-ponctuelle). En optique, on dit que les sources ponctuelles sont cohérentes spatialement alors que les sources étendues sont incohérentes spatialement.3. Rayonnement d’une source
Voyons quoi nous sommes capables à ce stade, si on nous propose tout un choix de sources en vue d’éclairer le salon. Le premier paragraphe nous dit que nous devons choisir une source qui émet entre 400 et 800 nm sinon, on n’y verra rien ! le second paragraphe nous recommande de choisir une source étendue de sorte à éclairer toute la pièce, il pourrait être ennuyeux de ne pas trouver les glaçons pour accompagner l’apéritif ! Et voilà tout ce que nous savons, jusque là, impossible de dire si il faut prendre du 100W ou du 20W et puis d’abord c’est quoi ce W ?? L’aspect qu’il nous manque c’est l’aspect énergétique, c’est de lui que nous aurons besoin pour affiner notre choix . Il est utile de savoir quelle énergie transporte une onde lumineuse (par exemple il pourrait être intéressant de savoir si la source va nous rendre aveugle ou non), cette étude énergétique des ondes lumineuses est appelée photométrie. Dans la plupart des cas, les sources sont observées directement ou indirectement par l’œil, celui-ci ayant une réponse particulière, on parle alors de photométrie visuelle. La grandeur fondamentale en photométrie est le flux lumineux. Le flux lumineux, noté F, est l’énergie transportée par unité de temps, son unité est le watt (W) (ah le voilà ce W !!) Ce flux lumineux peut s’exprimer en fonction du flux de chaque composante monochromatique. En effet l’énergie transportée par l’onde est la somme des énergies transportée dans chacune des composantes monochromatiques, aussi on peut écrire :
 est le flux spectrique.
Et là nous pouvons choisir notre lampe, si on veut une ambiance tamisée, il nous faudra une lampe de puissance relativement faible, si on préfère l’ambiance bleutée, il faudra que le flux spectrique soit maximum dans le bleu (400nm). A priori on pourrait donc s’arrêter là, mais nous somme sen si bonne voie qu’il serait dommage de s’arrêter et nous allons voir qu’il est possible de mêler la dimension spatiale à cette grandeur énergétique.
On considère un petit élément de surface dS centrée autour d’un point P d’une source étendue. Cet élément émet un flux
est le flux spectrique.
Et là nous pouvons choisir notre lampe, si on veut une ambiance tamisée, il nous faudra une lampe de puissance relativement faible, si on préfère l’ambiance bleutée, il faudra que le flux spectrique soit maximum dans le bleu (400nm). A priori on pourrait donc s’arrêter là, mais nous somme sen si bonne voie qu’il serait dommage de s’arrêter et nous allons voir qu’il est possible de mêler la dimension spatiale à cette grandeur énergétique.
On considère un petit élément de surface dS centrée autour d’un point P d’une source étendue. Cet élément émet un flux  dans un angle solide
dans un angle solide  autour d’une direction faisant un angle avec la normale
autour d’une direction faisant un angle avec la normale  à la surface (nous venons de décrire un petit bout de faisceau lumineux).
à la surface (nous venons de décrire un petit bout de faisceau lumineux).
 Figure 2
Figure 2

 est la luminance de la source au point P et pour la direction d’émission O. La connaissance de L permet de décrire complètement le rayonnement de la source.
Par exemple, on peut déterminer l’énergie émise par unité de surface de la source:
est la luminance de la source au point P et pour la direction d’émission O. La connaissance de L permet de décrire complètement le rayonnement de la source.
Par exemple, on peut déterminer l’énergie émise par unité de surface de la source:
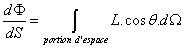


 Figure 3
Figure 3


| Grandeur énergétique | Unité | Définition |
| Flux énergétique Radiant flux | W | Energie par unité de temps |
| Intensité énergétique Radiant intensity | W.sr-1 | Energie par unité de temps et d angle solide |
| Luminance énergétique Radiance | W.sr-1.m-2 | Energie par unité de temps, d angle solide et de surface émétrice |
| Eclairement énergétique irradiance | W.m-2 | Energie par atteignant une unité de surface éclairée par unité de temps |
4. Eclairage ou pointeur laser
Après l’achat d’un nouveau salon tout confort, on souhaite renouveler l’éclairage de la pièce. Dans cet objectif, on se dirige vers un vendeur de sources lumineuses qui propose :- Une lampe L1, de puissance (ou flux lumineux) 20W et provoquant sur une surface placée perpendiculairement à 1m de la source un éclairement avec a=100
- Une lampe L2 de puissance 20W et provoquant sur une surface placée perpendiculairement à 1m de la source un éclairement avec a’=1
II. Les sources visibles (et IR) à spectre continu
1. Principe
Lorsqu’on chauffe un métal, on constate que celui perd sa couleur grise pour devenir rouge, puis jaune avant de fondre. Lorsque la température augmente, le métal s’est mis à émettre de la lumière visible. Cette petite expérience nous a permis de mettre en évidence un fait tout a fait général : tout corps rayonne. Le rayonnement d’un corps, c'est-à-dire la lumière qu’il émet, est fonction de la température du corps. Pour décrire le rayonnement des corps réel on peut utiliser le modèle du corps noir. Selon ce modèle le maximum d’émission est relié à la température par :
 , longueur d’onde qui appartient au domaine de l’infrarouge.
Cette loi de Wien va nous permettre d’interpréter le fonctionnement de certaines sources lumineuses courantes : les sources thermiques. En effet, si on chauffe suffisamment un corps, celui-ci émet de la lumière visible, pour que son maximum d’émission coïncide avec le milieu du domaine visible (600nm), il faut que sa température soit de l’ordre de 4800K, néanmoins pour des températures plus basses, une partie de la lumière émise sera dans le visible.
Chauffer un corps à des températures élevées est coûteux en énergie, d’autre part, si le corps n’est pas assez chaud, une grande partie de l’énergie lumineuse qu’il émet n’est pas visible. Ces deux constatations vont imposer la conception des sources thermiques.
, longueur d’onde qui appartient au domaine de l’infrarouge.
Cette loi de Wien va nous permettre d’interpréter le fonctionnement de certaines sources lumineuses courantes : les sources thermiques. En effet, si on chauffe suffisamment un corps, celui-ci émet de la lumière visible, pour que son maximum d’émission coïncide avec le milieu du domaine visible (600nm), il faut que sa température soit de l’ordre de 4800K, néanmoins pour des températures plus basses, une partie de la lumière émise sera dans le visible.
Chauffer un corps à des températures élevées est coûteux en énergie, d’autre part, si le corps n’est pas assez chaud, une grande partie de l’énergie lumineuse qu’il émet n’est pas visible. Ces deux constatations vont imposer la conception des sources thermiques.
2. lampe à incandescence

Les sources lumineuses les plus anciennes et peut-être les plus courantes dans nos ménages a été la lampe à incandescence. Dans ces lampes ordinaires, un filament de Tungstène est porté à une température d’environ 2800K. Il est placé dans une atmosphère gazeuse inerte pour ralentir sa vaporisation. L’émission de ces lampes peut être assimilée à celle d’un corps noir, la loi de Wien s’applique donc et on constate que le maximum d’émission se situe dans l’infrarouge ; Le rendement de ces lampes est par conséquent mauvais. Néanmoins, le spectre de ces lampes est un spectre continu, et couvre l’ensemble du domaine visible, de ce fait, l’œil a l’impression de voir une lumière blanche.
3. Lampe quartz-halogène
Ces lampes à incandescence fonctionnent sur le même principe que les précédentes. La différence tient en l’ajout d’un gaz halogène à l’intérieur de l’ampoule. Celui-ci se combine avec le tungstène déposé sur l’enveloppe et le redépose sur le filament. Prenons l’exemple d’une lampe quartz-Iode, il se produit entre le tungstène (W) et le diiode l’équilibre chimique :
4. Arc électrique au carbone
Ce sont des sources très lumineuses de faible surface qui fournissent un spectre continu proche de celui de la lumière du jour. Leur température est voisine de 4000K elles sont constituées de deux électrodes en carbone reliées à une source de tension continue ou alternative par l’intermédiaire d’un rhéostat indispensable pour limiter le courant dans le circuit. Pour amorcer l’arc, on met les électrodes en contact puis on les écarte d’environ 1cm. Le principal inconvénient de ce dispositif est que les électrodes se consument peu à peu et il faut régulièrement les rapprocher.
III. Les sources visibles à spectre discontinu
1. Lampes spectrales
Ces lampes émettent un spectre de raies caractéristiques des atomes qu’elles contiennent. Il existe deux types de lampes spectrales :- les lampes basses pression qui fournissent des raies fines (largeur de raies
 ) mais une faible émission par unité de surface.
) mais une faible émission par unité de surface.- Les lampes hautes pression qui fournissent des raies plus larges (largeur de raies
 ) mais une émission par unité de surface plus grande
) mais une émission par unité de surface plus grandeLa lampe est constituée de deux électrodes alimentées le plus souvent en alternatif via une inductance, les électrodes sont placées à l’intérieur d’une ampoule transparente contenant l’élément qui fournit le spectre d’émission. En régime stationnaire, la lampe est chaude et l’élément est sous forme vapeur, les électrodes produisent un flux d’électrons, les électrons entrent en collision avec les atomes enfermés dans l’ampoule qui subissent des transitions vers des états excités. Leur désexcitation produit l’émission de lumière. La longueur de la lumière émise dépend de la transition qui a lieu, et par conséquent de l’élément, si on note Em l’énergie de l’état excité et En l’énergie de l’état fondamental, l’énergie du photon émis est donné par :


2. Tubes fluorescents
Les tubes fluorescent, couramment appelés tubes néon fonctionnent sur le même principe que les lampes spectrales. En réalité le néon n’a pas grand-chose à voir avec ces tubes, il s’agit de tubes à vapeur de mercure. L’ampoule contient du mercure à très basse pression ce qui favorise l’émission des raies ultraviolettes. Sur les parois du tube est déposée une poudre fluorescente qui émet de la lumière visible lorsqu’elle est éclairée par de la lumière ultraviolette. Le spectre de ces sources dépend de la poudre fluorescente, il résulte de la superposition d’un spectre continu de fluorescence et de quelques raies du mercure, il ne contient pas d’ultraviolet (en théorie). Les poudres sont choisies pour que la lumière paraisse blanche à l’œil. L’intérêt de ces tubes par rapport aux lampes à incandescence usuelles est que toute l’énergie lumineuse se situe dans le spectre visible.
Figure 4
IV. Le laser : une source d’exception
1. Caractéristiques d’une source laser
Un laser est une source lumineuse qui possède deux caractéristiques remarquables : - une forte monochromaticité - un faisceau de faible section et faiblement divergent Ces deux caractéristiques font du laser une source exceptionnelle, puisque spatialement et temporellement cohérente. Les lasers couramment utilisés en laboratoire d’enseignement sont des sources de faible puissance lumineuse : quelques milliwatt. Le diamètre du faisceau à la sortie du laser est de l’ordre du millimètre et sa divergence de l’ordre du milliradian (à 10m du laser, la tache obtenue mesure 1cm). A la sortie du laser, l’éclairement reçu sur l’écran est de l’ordre de 1mW.mm-2 soit 1kW.m-2 ce qui est équivalent à l’éclairement de la surface terrestre par le soleil. Le faisceau laser est donc dangereux pour l’œil. Le laser n’atteint sa pleine puissance qu’après quelques minutes de fonctionnement, lorsque le régime permanent est atteint, la puissance est stable à quelques pourcents près.2. Principe de fonctionnement d’un laser Hélium-Néon
Intéressons nous au mécanisme de fonctionnement de ces lasers. Un laser est constitué d’une cavité résonnante, pratiquement, il s’agit de deux miroir dont l’un est parfaitement réfléchissant et l’autre possède un coefficient de réflexion de l’ordre de 99%, c’est par ce miroir qu’émerge le faisceau laser. L’espace entre les deux miroirs est calculé de sorte à ce qu’une seule longueur d’onde ne puisse exister ; le principe est tout à fait analogue à celui d’un circuit RLC qui ne laisse passer qu’une seule bande de fréquence. Entre ces miroirs se trouve un milieu matériel qui permet l’amplification du faisceau. En réalité un photon est produit à l’intérieur de ce milieu amplificateur, puis ce photon va effectuer des aller-retour à travers ce matériau et à chaque passage il va provoquer l’apparition de photons qui lui sont parfaitement identiques : c’est le phénomène d’émission induite mis en évidence par Einstein. Ce phénomène assure la monochromaticité du faisceau, en effet, chaque photon émis possède les mêmes caractéristiques que le photon originel : même phase, même longueur d’onde. Détaillons quelque peu ce phénomène d’émission induite. Tout d’abord il faut savoir que le matériau amplificateur subit un pompage, c'est-à-dire qu’on maintient la population des niveaux d’énergie élevée, plus importante que celle des niveaux d’énergie faible. Lorsqu’un photon traverse un tel milieu, il provoque la chute d’un électron d’un niveau d’énergie élevé vers un niveau d’énergie faible, cette transition électronique s’accompagne de l’émission d’un photon dont l’énergie est donnée par :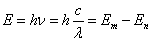

Figure 5
3. Diodes laser
On trouve parfois dans les laboratoires d’enseignement des sources laser qui n’ont pas grand-chose en commun avec les lasers que nous venons de décrire : les diodes laser. Ces diodes sont constituées d’une jonction p-n. La lumière est émise par recombinaison d’électrons et de trous qui se déplacent de chaque coté de la jonction. La monochromaticité de ces sources est comparables à celle des laser Hélium-Néon cependant la divergence du faisceau est nettement plus grande. On doit employer une lentille avec ces diodes lasers de sorte à focaliser le faisceau émergent. L’avantage de ces sources est un faible encombrement, un moindre coût et un rendement nettement supérieur.V. Source de Rayons X
1. Principe de fonctionnement
Toutes les sources de rayons X fonctionnent sur un seul et même principe. Il s’agit en général d’un tube à l’intérieur duquel on fait un vide plus ou moins poussé. A l’intérieur de ce tube on trouve :- un dispositif permettant de créer et d’accélérer des électrons
- un gaz sous faible pression
- une anode, ou cible vers laquelle le faisceau d’électron est dirigé
Chacune des parties que nous venons de mentionner participe à la production de rayons X, nous allons donc étudier chacune de ces parties.
2. Production et accélération du faisceau d’électron
Le faisceau d’électron est produit par un filament. Ce filament est porté à une température élevée ce qui a pour conséquence la production d’électron (effet Edison). Ce faisceau d’électron est ensuite focalisé vers un élément qu’on appelle Wehnelt. Les électrons ont alors une vitesse quasi-nulle, il faut ensuite les accélérer. Pour cela on impose à l’anode (cible) un potentiel très élevé. Notons VA le potentiel de l’anode et VC le potentiel de la cathode. La première chose à déterminer est le signe de la tension .
.

Figure 6


 est par conséquent positive.
Intéressons nous maintenant à l’énergie cinétique des électrons lorsqu’ils parviennent à la cible (en A).
Système : électron, masse m, charge q=-e
Référentiel : terrestre (assimilé galiléen)
Bilan des forces : la force électrique
est par conséquent positive.
Intéressons nous maintenant à l’énergie cinétique des électrons lorsqu’ils parviennent à la cible (en A).
Système : électron, masse m, charge q=-e
Référentiel : terrestre (assimilé galiléen)
Bilan des forces : la force électrique  On applique le théorème de l’énergie cinétique
On applique le théorème de l’énergie cinétique  Le travail de la force électrique se calcule aisément :
Le travail de la force électrique se calcule aisément :
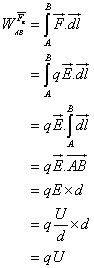 L’application du théorème de l’énergie cinétique fournit alors :
L’application du théorème de l’énergie cinétique fournit alors :


3. Production de rayon X
Le faisceau d’électron est à l’origine de la production des rayons X. deux phénomènes interviennent et sont la source des rayons X, cependant chacun de ces phénomène produit un type de spectre :- Un spectre continu
- Un spectre discret
Spectre continu On montre que toute charge accélérée rayonne. Lorsque les électrons atteignent la cible, ils passent à proximité des noyaux de la cible et l’interaction électrostatique tend alors à freiner les électrons. Ce ralentissement provoque le rayonnement des électrons (c’est le Bremsstrahlung) qui perdent de cette façon une partie de leur énergie. Les électrons pouvant passer à une distance continûment variable des noyaux, le spectre qui en résulte est un spectre continu contenant des rayons X.

Figure 7



- le flux d’électrons incidents, plus il y en a plus on observera de rayons X
- le numéro atomique de la cible, plus il est grand, plus l’interaction électron matière est importante et par conséquent plus le flux de rayons X sera important
- l’énergie des électrons incidents, plus l’énergie est grande, plus elle peut être distribuée sur tout le spectre.
On peut tracer le flux de photons émis dans une direction en fonction de la longueur d’onde, on obtient une courbe dont l’allure est la suivante.

Figure 8


Figure 9

Figure 10
4. Les contraintes
Comme tout système industriel, un tube à rayon X doit avoir un rendement aussi bon que possible. D’après ce qui a été dit précédemment, le rendement dépend :- de l’intensité du courant traversant le filament, c’est lui qui provoque le chauffage du filament et par conséquent la production d’électron plus il est élevé, plus il y aura d’électrons produit
- la tension accélératrice, plus elle est grande, plus l’énergie des électrons est grande, donc plus on aura de rayons X
- la cible, son numéro atomique est un facteur déterminant dans la production de RX
En pratique le rendement des tubes est plutôt médiocre, étudions le cas de quelques cibles.

5. Le tube de Crookes
Le tube de Crookes est le premier tube à Rayon X qui a été conçu, il n’est plus utilisé aujourd’hui. Le tube de Crookes est constitué d’une ampoule contenant de l’air sous une pression résiduelle d 100Pa. La cathode est en aluminium, la haute tension est provoquée par induction, on observe alors une ionisation de l’air résiduel sous forme d’un faisceau d’électron qui va heurter la cathode et produire ainsi des rayons X. Ce procédé ne permet qu’une production intermittente de rayon X.6. Le tube de Coolidge
Le tube de Coolidge est une amélioration du tube de Crookes, le tube contient un vide poussé (10-4Pa) et est recouvert d’une couche de plomb. Le filament de ce type de tube est en Tungstène. La cathode est soit en tungstène soit en Rhodium. On distingue deux types de tubes : - les tubes à fenêtre latérale, le filament a la forme d’un solénoïde, il est placée en face de la cible qui est biseautée.
Figure 11

Figure 12
7. Tube à anode tournante
Les tubes à anode tournante ont été développés pour améliorer l’évacuation de la chaleur dans les tubes à rayons X. dans ces tubes, l’anode est mise en rotation par un moteur tournant à une vitesse de 3000 à 9000tr/min. Ce dispositif permet d’offrir à chaque instant une surface différente au faisceau d’électron ce qui a pour effet de distribuer les échanges de chaleur sur une surface plus grande.
Figure 13

